Aujourd’hui Bernard prend la plume et l’humour, pour partager son aventure cyclotouristique entre amis. 5 jours de vélo, de Montpellier à la Camargue – 5 jours à la découverte de cette région qu’ils connaissaient peu, à deux pas de chez eux.
Un voyage commence toujours avant le voyage
Même quand c’est un voyage à vélo. Surtout si c’est un voyage à vélo. Il s’agit d’anticiper tout ce qui pourrait arriver de désagréable si on n’anticipait pas : une crevaison, des rustines trop vieilles, un tube de colle si asséché qu’il ressemble à un caillou, une pompe oubliée à la maison, des démonte-pneus qui se sont égarés, une chaine qui se brise parce qu’on a omis de la graisser, un porte-bagage qui se détache parce que les boulons se sont enfuis, sans compter une ribambelle infinie d’autres calamités tellement improbables qu’on reste pétrifié lorsqu’elles surviennent.
Je suis un occidental. Dans d’autres régions du monde, on s’en remet à Dieu ou au Destin. Pour ma part, j’ai pas trop confiance dans ces trucs-là. J’anticipe et je planifie. Donc, dès Bruxelles, je réunis les pièces et outils nécessaires. Surgissent les grandes questions métaphysiques : les boulons pour le porte-bagage, c’est du 4 ou du 5 ? Les valves, celles avec le petit bitogneau qui dépasse et que je connais depuis mon enfance, ce sont des « Presta » ou des « Schrader » ? Et le tournevis ? Plat ou cruciforme ? La Camargue est encore lointaine. D’ailleurs existe-t-elle ? Le grand jeune homme qu’héberge en ce moment Sabine, un spécialiste de marketing sorti d’une grande école de commerce, lui a demandé : « C’est quoi, la Camargue ? ».
Par delà son inculture, il a raison. La Camargue, ce n’est encore que l’objet de notre désir commun à Sylvie, Sabine, Denis et moi. A l’instar de la fille de Sylvie et Denis, qui a parcouru 27 000 Km à vélo du nord du Québec au sud de la Patagonie, nous nous préparons à parcourir 260 Km à travers les terres inconnues de la Camargue. Frissons !
Arrive la veille du départ. Denis me montre les deux vélos qu’il préparés : imparable et impeccable, il a tout prévu. Rustines fraîches, démonte-pneus chromés, énorme pompe qui vous regonfle un pneu de camion en deux coups de piston, avec embout ultra-tolérant qui réconcilie Presta et Schrader, les deux ennemis héréditaires, sacoches imperméables pour affronter le déluge, selle rembourrée pour petit derrière sensible, etc., etc., et même un compteur kilométrique dont la forme, analogue à celle d’un smartphone, laisse supposer des fonctions innombrables et résolument high-tech (du genre longitude, latitude, altitude, pression sanguine, calculatrice, thermomètre, baromètre et moulin à poivre). Je suis impressionné et mesure mon amateurisme : j’ai oublié ma pompe à Bruxelles, j’ai eu la flemme de changer les pneus arrière, pourtant complètement lisses. Quant aux porte-bagages, je n’ai réussi à les fixer qu’au prix d’un de ces bricolages que Levi-Strauss a si bien repérés chez les peuples archaïques. À défaut de m’en remettre à Dieu ou au Destin, je me livre, stoïque, au cours du monde.
Jour de départ.
Sylvie et Denis ont des habitudes de chineurs et savent que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. C’est donc à 7 heures que nous nous élançons : le premier coup de pédale, c’est comme la première gorgée de bière : le plaisir d’une renaissance dans la fraicheur du matin. Dans la clarté du jour naissant, notre parcours futur se dessine dans ma tête comme une épure céleste : nous longerons le mas des Trois Cloches et traverserons la nationale 113, puis il y aura la première grimpette dans un lotissement et le passage sous l’autoroute. Mais voilà que l’adversité guette : devant nous, des engins de chantier et d’énormes camions soulèvent la poussière crayeuse. Il n’est plus possible d’emprunter ce chemin qui, dans le passé, nous a si souvent conduit à la plage. Obstacle, barrage, barrière, clôture, tout ce qui m’empêche d’avancer fait renaître en moi la fureur dans laquelle me mettait, quand j’étais écolier, la lenteur du garçon qui me précédait dans le rang pour entrer en classe.
Mais Sylvie et Denis connaissent le coin par cœur et un itinéraire alternatif est rapidement imaginé. Lequel descend et nous convie au bonheur de la roue libre. Puis remonte et il faut peser sur les pédales et souffrir un peu. Souffrance attendue. Faire du vélo, c’est trouver le bon rapport entre le désir d’avancer et la douleur des genoux ; c’est un exercice existentiel. J’ai ma technique : trouver le bon rapport entre plateaux et pignons, celle qui fait le moins mal tout en maintenant l’avancée, si faible soit-elle, tour de pédale après tour de pédale, avec l’éternité pour soi, sans aucunement espérer que ça cesse de si tôt, comme si on était dans les Rocheuses ou dans la Cordillères des Andes, mais tout en sachant quand même, dans un coin de sa tête, qu’on est seulement à Saint-Jean-de-Védas, la ville voisine de notre point de départ.
Nos huit roues tournent, en ligne sinueuse
Et nous voilà sur une belle piste qui longe la dune, ponctuée des accès à la plage et de douches pour les baigneurs. Du haut de nos vélos, nous méprisons secrètement ces touristes qui n’ont d’autre but que de s’alanguir au soleil. Juchés sur nos machines, nous sommes des seigneurs à la conquête d’horizons inouïes et de l’univers infini.
Mais bientôt les seigneurs ont une petite faim. Ils foncent dans un labyrinthe d’allées étroites qu’ils parcourent fougueusement, le visage fouetté par les branches des lauriers roses, à la recherche du point d’où tout doit partir, l’origine absolue, « Point Zéro », lieu obligé pour le premier casse-croute d’une héroïque aventure. Plus tard, les voici repus et vautrés dans l’herbe ombragée, tandis qu’à deux pas leurs vélos les attendent comme des chevaux fidèles au bivouac des cow-boys.
L’épopée reprend
Ils entrent en vainqueurs dans la cité fortifiée que Saint-Louis avait fait construire pour le départ de la septième croisade. Mais pour eux, il ne s’agit pas tant de partir combattre les infidèles que de repérer leur hôtel et bien que celui-ci ait pour nom « Le médiéval », la quête est plutôt prosaïque. On s’imagine souvent que faire du vélo, c’est être installé au sommet d’une selle et, grâce à l’élan et à d’incessants mouvements infimes du guidon, se maintenir en équilibre dans une chorégraphie gracieuse et aérienne. Certes, c’est ainsi parfois. Mais faire du vélo, ce peut être aussi, le pousser à côté de soi, curieux animal à deux pieds et deux roues, quadrupédie laborieuse et légèrement claudicante, le torse déjeté pour pouvoir tenir le guidon et les chevilles qui tentent d’éviter le choc de la pédale. C’est ce que nous faisons maintenant dans la rue centrale d’Aigues-Mortes, frayant un chemin à nos vélos que les sacoches gonflées rendent fessus, encombrants et encombrés, étreints dans la foule des touristes qui s’écoule lentement en nappes piétonnes, épaisses et transpirantes, sans cesse ralentie par l’attention qu’un ou l’autre de ces bipèdes se met à porter subitement à des cartes postales, des objets souvenirs, des produits du terroir, des poteries artisanales, des sachets de sel de Camargue, des bouteilles de vin local, des saucissons de taureau, des poupées en costume d’arlésienne, des savonnettes parfumées à la lavande, des bijoux fantaisie, des fringues estivales, le menu d’un restaurant, la devanture d’une pâtisserie, etc.
Finalement l’hôtel Le Médiéval se révèlera n’être pas à la hauteur de son nom : pas de donjon, de chemin de ronde, de douve, de pont-levis, d’échauguettes, de créneaux, de meurtrières, de courtines ni de glacis. Pas de cachots profonds, pas de salle de tortures inquisitrices, brutales ou raffinées. Rien de tout cela, même pas des grandes pièces glaciales aux immenses cheminées de pierre sculptée. Simplement un deux étoiles standard, avec sa petite piscine.
Deuxième matin.
La petite troupe est fraîche comme le jour naissant. Sabine et Sylvie se sont dopées à la fougasse, spécialité locale en laquelle le moelleux alvéolé de la pâte s’oppose, pour le bonheur du palais, au glaçage cassant de la surface. Nous avançons sur la route déserte. Pas un bruit, juste le léger chuintement de nos pneus sur l’asphalte. Les haies, les arbustes, les étangs et les marais salants n’ont choisi d’exister que pour être le décor de notre roulage tranquille. Nous sommes dans le bonheur d’être ensemble, sans qu’aucun de nous ne soit distrait de ses pensées vagabondes.
Il m’apparaît soudain que ce n’est pas moi qui roule sur la surface sphérique de la Terre. C’est la planète qui, par sa rotation d’est en ouest selon les lois apaisées de la mécanique céleste, fait tourner mes roues et actionne le mouvement régulier de mes jambes sur les pédales. Mes muscles et mes tendons, mon pédalier et mes pignons sont les ultimes appendices de la grande horlogerie galactique.
La Camargue s’affiche
Le paysage change : partout des étangs, des canaux, des enclos où paissent de beaux chevaux blancs. Puis, tout à coup, les premiers taureaux. Il faut bien que la réalité ressemble un peu à son concept, autrement dit à un cliché : pas de Camargue sans taureaux ni chevaux, ni mas, ni manade. Denis prend des photos. Nous poursuivons. Dans la chaleur désormais forte, mon esprit divague. Moi et mon vélo, nous serions un taureau, car le guidon ressemble vaguement à une paire de cornes et nous foncerions avec une intrépidité aveugle et une fièvre quasi tauromachique. Mais me vient à l’idée que ce genre d’histoire se termine généralement mal pour le taureau. Alors, je m’imagine que moi et mon vélo sommes un cavalier et sa monture, fringants et pleins d’élégance.
Nous cherchons les chemins de traverse, ceux qui nous mèneraient au cœur de l’action, au milieu des innombrables canaux au bord des étangs. De tels chemins, il y en a, mais ils sont clos. Il semble que la nature camarguaise se soit privatisée. Les mas sont devenus des hôtels et les chevaux sont harnachés et prêts pour les promenades des touristes. A peine trouvons-nous un coin d’ombre minuscule entre un sentier et le Petit Rhône. Nous nous préparons pour la traversée de celui-ci : inoubliable croisière de quatre minutes sur un bac minuscule.
Arrivée à notre mas. Est-ce notre hôtel ? Une énorme grange et plusieurs corps de bâtiments entourent une cour. Nous sommes dans une ferme. Seuls quelques fauteuils profonds, dans un coin, signalent que c’est aussi un hôtel. Le patron, rencontré plus tard, se révèle aussi hybride que son établissement. Personnage massif, on pourrait le croire silencieux comme un homme de la terre. En réalité, il parle, il parle beaucoup et très vite se lance dans des considérations géopolitiques de haute volée, dont il ressort que ce sont les écologistes qui font le malheur de la Camargue. Sylvie, Denis et moi sommes un peu gênés, partagés entre le souci de garder un contact agréable avec notre hôte et la volonté de ne pas acquiescer à des idées que nous réprouvons. Nous mettons fin à la conversation, car c’est bientôt l’heure du dîner avec son inévitable steak de taureau.
Réveil et coup d’œil sur la cour que sillonnent nonchalamment quelques chiens. Nous partons, traversons les Saintes-Maries-de-la-Mer, que nous abandonnons vite, car notre but, c’est la « Digue à la Mer » longue bande qui sur une trentaine de kilomètres sépare les marais de la mer. La piste longe la plage et nous dépassons bientôt les derniers baigneurs. Nous pouvons à nouveau nous voir comme d’intrépides découvreurs. Joie et fierté de dominer le paysage plat jusqu’à l’horizon, même si dans les étangs les flamands roses, la tête sous l’eau, affairés à saisir leur proie, nous montrent leur derrière.

Les flamands de Camargue : Crédit photo : Bernard Rey
Ça roule. Puis soudain, ça roule un peu moins bien, puis plus du tout.
Le sable. L’enlisement. Il faut descendre de vélo et pousser. Chacun de nos pas s’amortit lamentablement dans cette matière qui se dérobe. Nous commençons à gamberger : trente kilomètres ainsi. Nous sommes quatre cyclistes égarés et à bout de souffle, sous le soleil implacable, quelque part dans les dunes entre Tindouf et Tamanrasset. Bientôt la dernière goutte d’eau sera avalée et un à un nous succomberons à la dessiccation dans une interminable agonie. Mais pour échapper à cette fatalité, nos quatre intelligences conjuguées nous livrent une solution astucieuse : pourquoi ne pas aller sur la plage où le sable humide sera assez dur pour supporter les roues des vélos ? Nous y allons, mais à parcourir les deux ou trois kilomètres de largeur qu’a la plage à cet endroit, nous ne trouvons nul part un sol assez solide pour que nous y roulions. Accablés, nous retournons sur la piste, laquelle est bientôt libre de sable et roulante. Nous reprenons notre avancée, non sans nous moquer de nous-mêmes qui avons passé deux heures à un détour inutile. Le vélo est une pratique d’auto-dérision.
Soudain, changement de décor : la neige. Une langue d’une blancheur éclatante, comme au printemps en haute montagne. Oublié le Sahara, nous sommes dans la Cordillère des Andes. Grimpeurs de l’extrême, nous avons, depuis l’aube, escaladé quelques mille mètres qui, cumulés avec ceux des jours précédent, nous amènent maintenant sur les hauts plateaux. Nous nous attendons à voir surgir un lama ou un indien Quetchua dans son poncho multicolore. Sauf que le paysage est uniformément plat, que nous sommes à l’altitude zéro et qu’il fait environ 35°. Pourtant la neige est bien là, cristalline et immaculée. Nous abandonnons les vélos et descendons du talus pour rejoindre cette nappe blanche intrigante. Oui, ce sont bien des cristaux blancs, mais c’est du sel, de la fleur de sel naturellement déposée par évaporation de l’eau de mer. Notre voyage, c’est la route du sel à vélo.
Arrêt casse-croute prés du phare de la Gacholle, seul point d’ombre de tout le delta du Rhône. Nous y apprenons ce qu’est une soussuire, mais je ne ferai pas au lecteur l’affront de supposer qu’il ignore le sens de ce mot. La chaleur est forte et notre idée commune est que l’héroïsme, comme les boissons alcoolisées, doit se consommer avec modération. Nous n’irons donc pas jusqu’aux Salins-de-Giraud ni même jusqu’au phare de Beauduc, mais nous sommes partants pour parcourir les quelques kilomètres qui nous séparent de la mer.
Voici la plage
Le sable mêlé au sel compose une surface craquante qui crisse agréablement sous nos pas. C’est comme si nous marchions sur une immense tarte au citron meringuée. Voilà ! C’est ça la réponse aux grandes questions métaphysiques : qu’est-ce que l’univers ? C’est une gigantesque tarte au citron meringuée et nous, pauvres gnomes, nous avons la chance d’habiter sa surface et la malchance d’avoir des bouches trop petites pour la manger. C’est ça le drame de la condition humaine.
Après quelques brasses dans la mer, lent retour vers le mas qui nous accueille fourbus. Nous attendons le diner en nous demandant ce qui, ce soir, prendra la place du steak de taureau de la veille. L’heure arrive. Nous descendons au rez-de-chaussée où se trouve la salle à manger. Ambiance étrange : la réception, par laquelle on accède au restaurant, est close ; aucun bruit, aucune lumière du côté des cuisines. L’ensemble est désert. Peut-être sommes-nous en avance. Nous attendons. Mais l’évidence progressivement s’impose : on nous a oubliés. Pas de repas ce soir. Famine sur la Camargue. A moins de faire fi de notre fatigue et de ré-enfourcher les vélos pour avaler, faute de mets exquis, les huit kilomètres qui nous séparent des Saintes-Maries. Je retrouve les émotions de quand j’était tout petit et que le biberon n’arrivait pas assez vite : détresse, déréliction, abandon.
Finalement, après négociations téléphoniques, un taxi vient nous prendre pour nous conduire au village. Repas, puis c’est le patron de l’hôtel, le célèbre anti-écolo qui vient nous rechercher en voiture. Sur la route du retour, il s’excuse et nous explique qu’il a eu une journée éprouvante à courir aux quatre coins de la Camargue pour quérir, en des endroits divers, des juments et leurs petits. C’est que, voyez-vous, c’est ce dimanche la fête du ruban.
Le ruban ? Quel ruban ?
Il nous explique : dans la tradition de la Camargue, les filles de seize ans, à condition d’être vierges, se voient remettre, le dernier dimanche de juillet, un ruban, lors d’une cérémonie fort prisée et hautement folklorique. C’est lui, notre Philippe, patron d’hôtel et oublieux des clients affamés, qui est chargé de vérifier la pureté des demoiselles, ce dont, s’empresse-t-il de préciser, il s’acquitte de manière très distante. Mais sa tâche principale, poursuit-il, c’est de préparer, pour ce jour-là, un lâcher de cent juments, chacune pourvue de son poulain. Grandiose affaire ! Pas très claire cependant, car cette célébration de la virginité pourrait bien être en fait un éloge de la fécondité. Mais il ne nous laisse pas faire l’analyse ethnographique de cette très locale manifestation culturelle et poursuit : « La Camargue, voyez-vous, au début du XXème siècle, ce n’était plus rien, zéro, le néant. Celui qui l’a remise debout, c’est Frédéric Mistral, ainsi que son émule le Marquis de Baroncelli. » Et de poursuivre sur ce dernier personnage, sa généalogie depuis l’époque des Médicis, son homosexualité qui lui valut des ennuis, ennuis dont il évita les conséquences grâce à la protection du Maréchal Pétain. Nous comprenons qu’il y a là tout un héritage de traditions dont le massif Philippe est si fier que ça le pousse à se bouger l’imposant postérieur pour poursuivre chaque jour, dans les enclos camarguais, chevaux et taureaux en courses effrénées. « Si nous nous trouvons ensemble dans cette voiture ce soir, conclut-il, c’est grâce à Mistral et à Baroncelli et au Maréchal ». Nous sortons de là, modérément satisfaits de devoir à Pétain d’avoir parcouru sans fatigue la distance entre notre diner et notre lit.
On rentre à la maison
Le lendemain nous trouve aux prises avec un ciel bouché et de lointains mais persistants coups de tonnerre. Pas assez pour décourager les pélerins même quand, comme nous, ils sont dépourvus de pélerines. Nous partons et progressons avec l’assurance de cyclotouristes aguerris. Tonnerre encore, mais qu’importe, c’est là-bas plus à l’ouest ; ce n’est pas pour nous. Nous nous préparons à suivre les méandres du Petit Rhône. Une goutte sur mon bras gauche, une autre et une autre encore. « Il pleut ! » crient en cœur Sabine et Sylvie. En quelques secondes, un déferlement. Chaque goutte me fait comme une piqure glaciale dans le dos à travers le T-shirt, puis plus rien car je suis trempé. Je découvre ainsi une réalité inouïe : les cyclistes aussi sont mouillés par la pluie. J’avais jusqu’ici l’idée un peu confuse, mais solidement installée dans ma tête, que lors des averses les gouttes restaient gentiment suspendues le temps du passage du cyclopède pour retomber ensuite derrière lui.
Le beau temps revient, si bien que sur un tronçon de la « Via Rhôna », c’est l’ombre que nous cherchons. Nous n’avons finalement d’autre option, pour le temps du casse-croute, que de nous réfugier sous un pont métallique qui enjambe le canal. Soudain c’est l’enfer cacophonique : un bruit terrifiant, implacable et tonitruant s’élève et se poursuit en un roulement monstrueux. A l’instar de nos ancêtres les Gaulois dont on sait le courage absolu, mais dont la seule peur était que le ciel ne leur tombe sur la tête, la certitude nous étreint que la chute céleste, durant des siècles redoutée, est en train de s’accomplir. Nos machoires, occupées à broyer les dernières tranches de saucisson de taureau (22% de taureau et le reste c’est du cochon, comme cela est finalement avoué en toutes petites lettres sur l’étiquette) soudain se raidissent. Jusque dans la moindre des cellules de notre corps, les échanges gazeux se figent tandis que l’hormone de l’apocalypse vient baigner nos artérioles. Mais voilà qu’un coup d’œil vers le haut nous rassure : ce bruit, ce n’était que celui d’une voiture parcourant le pont métallique. Le grand écroulement cosmique, ce sera pour la prochaine fois.
Mais l’alerte a été rude. Et c’est avec ravissement que, parvenus à Saint-Laurent d’Aigouze, nous goutons à l’harmonie bienfaisante de l’humain et du cosmos dans l’adorable jardin fleuri et ombragé qui nous attend à l’hôtel. « On se croirait à Bali », nous dit Sabine, qui a voyagé en mille lieux. Une musique discrète et vaguement planante nous incite à la croire.
Contre vents et marées
 Le lendemain nous fait jouir du silence et de la fraicheur d’un dimanche matin. Arrêt à la Tour Carbonnière. Sylvie, Sabine et moi l’escaladons. Derniers regards sur cette parfaite surface plane qu’est la Camargue tout juste agrémentée de l’argent des canaux et des étangs, de l’or des zones sablonneuses et de la verdeur de la salicorne dans les soussuires.
Le lendemain nous fait jouir du silence et de la fraicheur d’un dimanche matin. Arrêt à la Tour Carbonnière. Sylvie, Sabine et moi l’escaladons. Derniers regards sur cette parfaite surface plane qu’est la Camargue tout juste agrémentée de l’argent des canaux et des étangs, de l’or des zones sablonneuses et de la verdeur de la salicorne dans les soussuires.
Encore quelques tours de roue et nous voici sur la piste du Grand et du Petit Travers. C’est le chemin du retour, à la fois identique et tout autre à celui de l’aller. Car nous défaisons ici cette distance au logis que nous avons courageusement construite il y a cinq jours. Ce qui était alors ouverture sur la nouveauté et l’inconnu, nous rapproche désormais de notre ordinaire. Ce chemin, devenu familier par l’itération, est quasiment l’antichambre de chez nous, avec un petit air domestique, rassurant, mais sans noblesse.
Pourtant, un petit quelque chose d’inhabituel se fait sentir, quelque part dans les pédales ou le guidon, dans les jambes et les bras. Encore quelques centaines de mètres et ça se précise : à effort égal, nous n’allons plus aussi vite. C’est même de plus en plus dur. Il se dit que les chevaux vont de plus en plus vite quand ils sentent l’écurie. Apparemment, ce n’est pas le cas des vélos. Mais voici la clé de l’énigme : le vent. Le vent joue contre nous. Et voilà que je fais une nouvelle et éprouvante découverte : les cyclistes sont soumis au vent. Pour moi, le vent, c’était la divinité bienfaisante des éoliennes et de la navigation à voile, celle qui fait danser sur les vagues les kyte-surfeurs et les véliplanchistes. Voilà que je découvre une force arbitraire et despotique qui peut choisir, à son gré, de rendre véloce le vélocipédiste ou au contraire de le transformer en un bœuf attelé suant et trébuchant sur un chemin que la lenteur rend interminable
La folie du retour
Enfin, voici les rues tranquilles de Lavérune, village montpellierain, notre point de départ et d’arrivée. Nous avons parcouru 260 Km en cinq jours. Nous sommes les rois du cyclotourisme. L’an prochain, c’est décidé, nous ferons Lavérune-Pékin. Les kirghizes et les mongols qui, surgis de leurs yourtes, nous verront avancer dans la steppe, resteront pétrifiés d’admiration devant notre fabuleuse endurance. Nous leur expliquerons que nous la tenons d’avoir fait la traversée de la Camargue, à l’instar de ces marins qui, jadis, se glorifiaient d’avoir doublé le Cap Horn.
Crédit photo de couverture : Pixabay
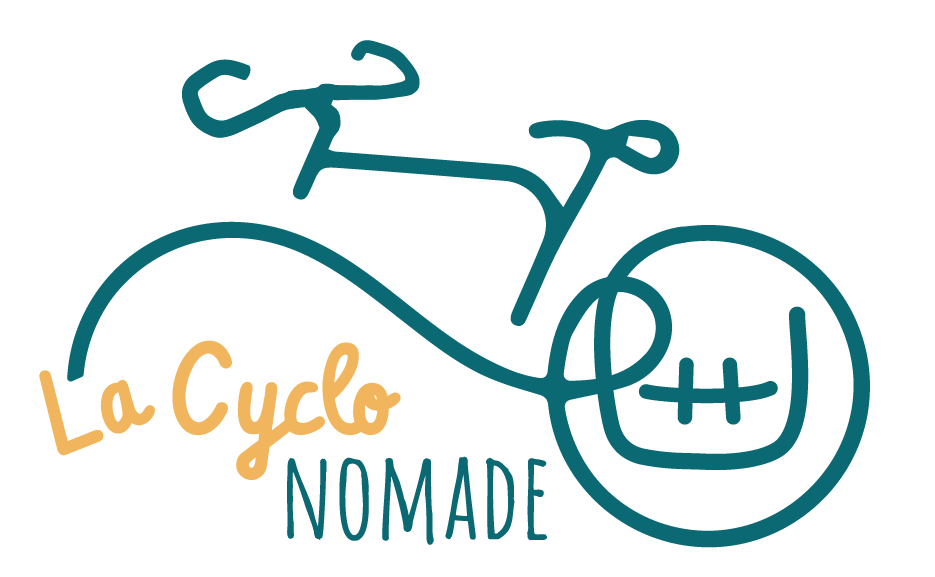






0 commentaires